Il y a précisément un siècle, un article a été publié dans le Bulletin de la Société d’histoire de la Pharmacie sur ce sujet, signé par Prosper Van Melekebeke. Il parlait d’un ouvrage « devenu rare, écrit vers 1610 et publié en 1631 ». Une note de bas de page précisait que ce n’était pas la première édition et que cette dernière avait été publiée en 1613. Il se trouve que cet ouvrage (et cette édition de 1613) se trouve désormais numérisé à la BIU santé Paris-Cité. Il est donc intéressant de le faire connaître davantage pour encourager les curieux à y jeter un coup d’oeil.
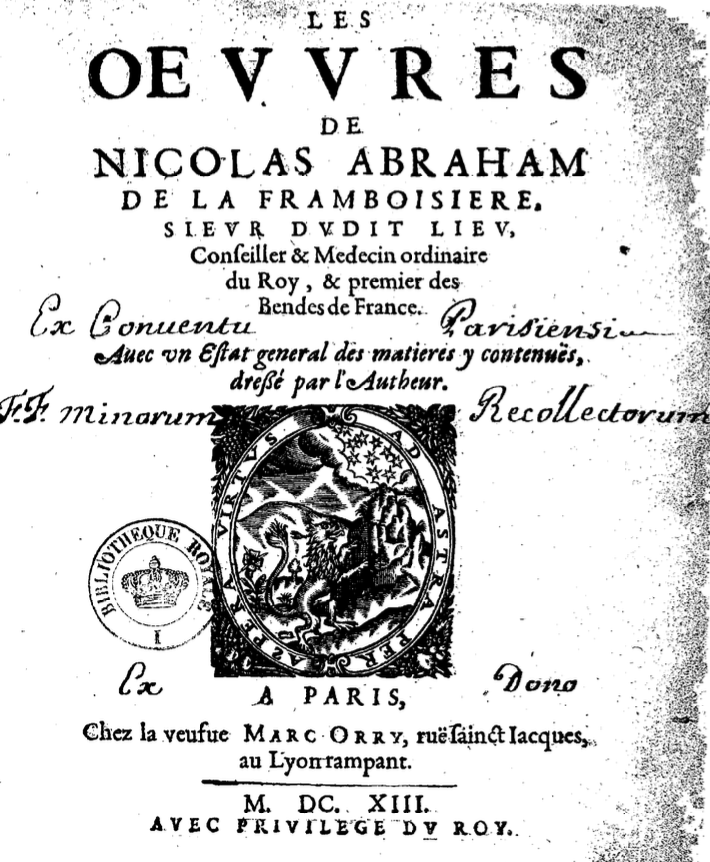
« L’ouvrage est divisé en sept « tomes » ou livres, dont chacun porte une dédicace différente. L’une est adressée à un membre de la famille royale, l’autre à un personnage illustre de l’époque, puis dans le premier livre, le sieur de La Framboisière, conseiller et médecin ordinaire du roi, traite en deux chapitres l’histoire de la sphère terrestre ; dans le premier, des parties réelles du monde ou de l’histoire naturelle; dans le second, des parties supposées du monde ou de la cosmographie.
Le deuxième livre porte comme titre : « Du gouvernement nécessaire à chacun pour vivre longuement en santé, selon l’âge, selon les saisons, durant les épidémies, ainsi que des lois pour le régime préventif de la migraine, de l’épilepsie, des catarrhes, du mal d’yeux, de la colique, de la gravelle, de la goutte ». Le troisième livre réunit les lois médicales appliquées à la guérison des maladies, avec des consultations d’autres médecins au sujet de chaque maladie.Le quatrième donne un ensemble de lois de la chirurgie pour la guérison des maladies externes ».
Le cinquième livre est celui qui nous intéresse le plus : il renferme les règles à suivre pour la préparation des médicaments tant simples que composés. « Il est dédié à Monseigneur le Frère du Roi et Mesdames ses Sœurs.
Il leur fait savoir qu’il a trouvé le moyen de présenter les médicaments sous une forme nouvelle, appétissante, agréable, pour que leur auguste personne puisse vaincre le mal par les remèdes ainsi présentés. Il y a aussi un avis aux apothicaires de France, dans lequel La Framboisière se défend de vouloir divulguer les secrets de leur art, mais il décide d’employer la langue française afin d’être plus clair et mieux compris.
Dans la première partie de ce livre, l’auteur indique la manière de préparer les médicaments simples (il entend par là la confection des extraits des plantes), soit par expression des huiles, soit par distillation des huiles essentielles, soit par macération et digestion, soit par macération et distillation du dissolvant ».
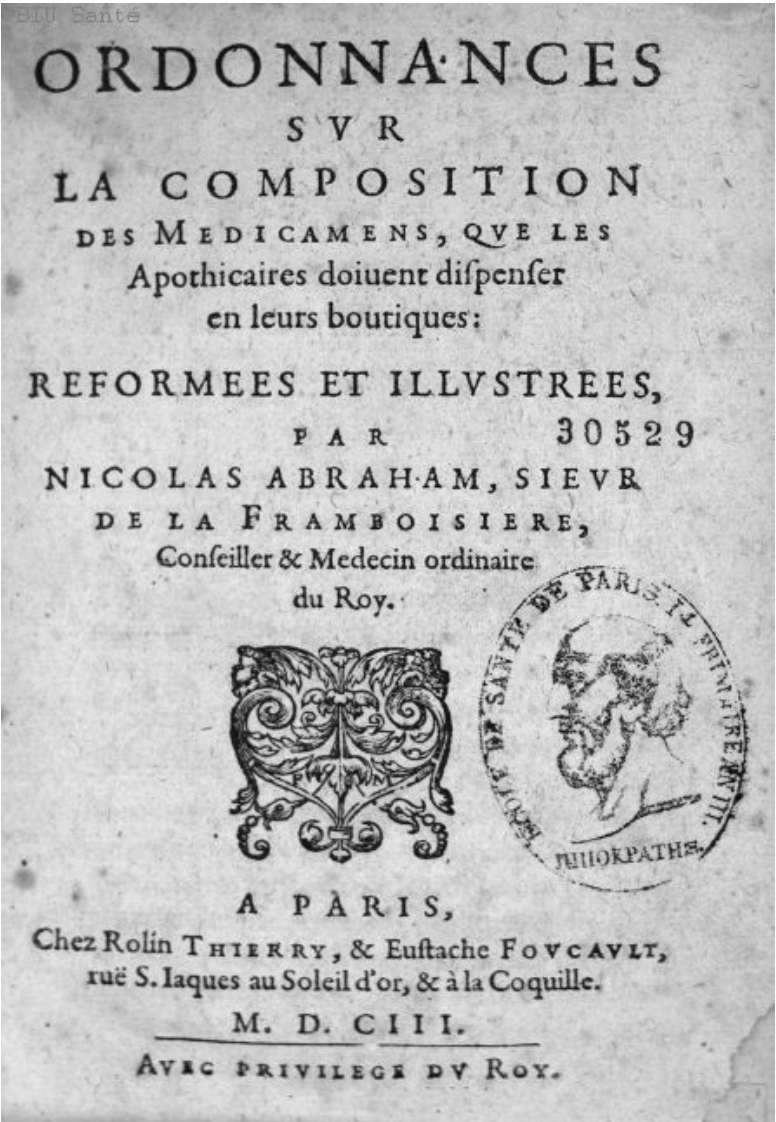
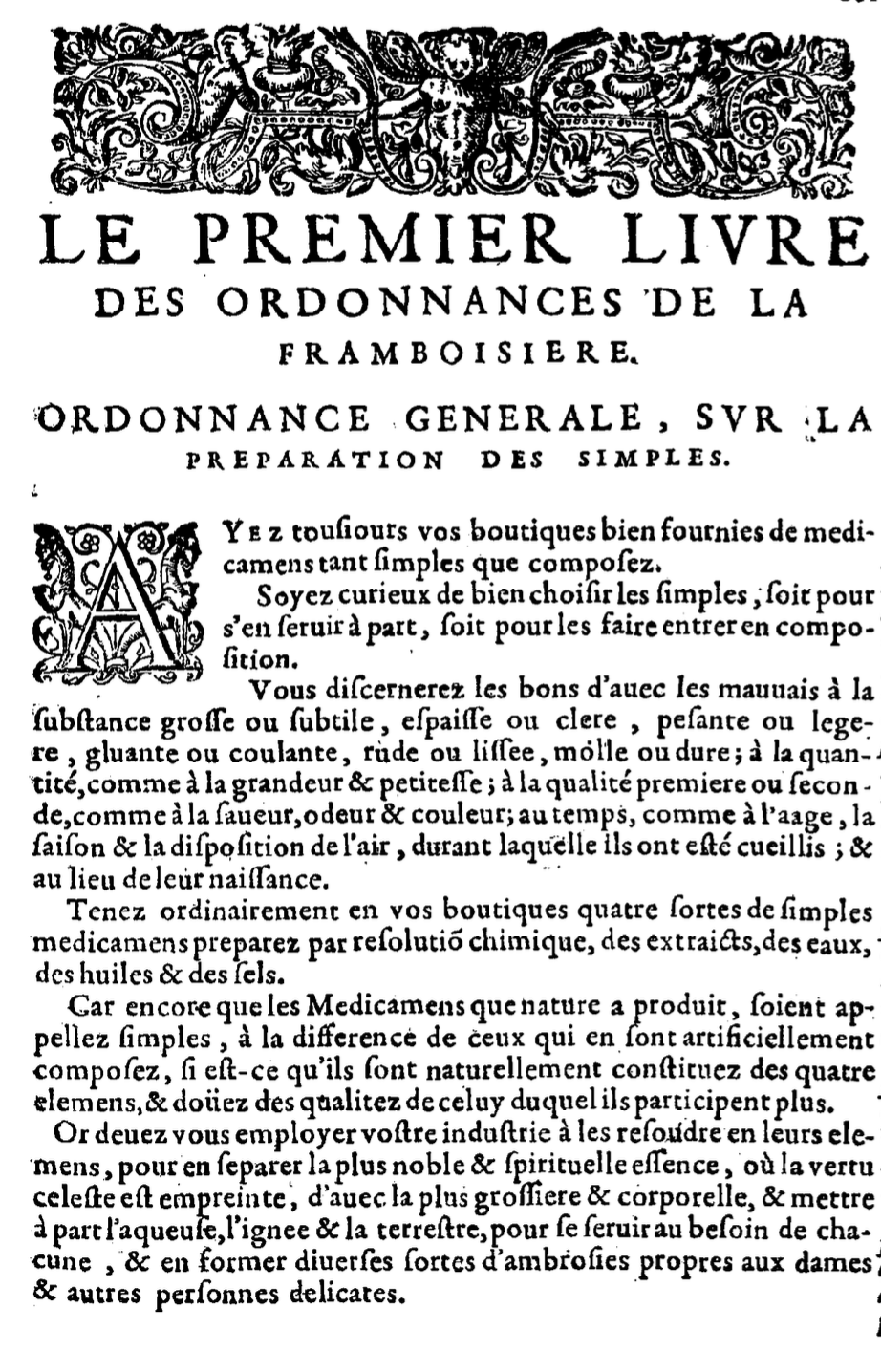
L’auteur explique qu’il existe trois sortes d’extraits : les purgatifs, les apéritifs et les roboratifs, et il liste les plantes ou les animaux qui entrent dans chacun de ces extraits. Pour chacun d’entre eux, il donne le détail de leur préparation et de la façon de choisir le principal ingrédient.
A titre d’exemple, voici ce que dit La Framboisière à propose de l’extrait de Séné (retraduit en terme moderne) : « Prenez une demie-livre de Séné Oriental, avec une demie-once d’anis. Laissez les tremper et digérer au bain-marie, en eau de pommes odoriférantes, rendue aigrette avec l’esprit acide de vitriol ou de soufre. Après que l’eau sera teinte en couleur de rubis, vous la séparerez par l’inclinaison et mettrez encore autant de Séné et d’anis infusés dedans. Puis versez l’infusion dans un alambic de verre, et en distillez l’eau par chaleur humide. Cela fait, vous apercevrez la pure essence de Séné au fond, en consistance de miel. »
La Framboisière ajoute en note « le bon Séné doit avoir les gousses noirâtres, tirant sur le vert, un peu amères… Notre Séné n’est pas de telle vertu, que l’Oriental. Le Séné du Levant dessèche au premier degré, et échauffe au commencement du second. Il nettoie, digère et purge doucement la mélancolie et la bile adulte. »
Le chapitre suivant est consacré aux eaux distillées. A la fin, l’auteur donne une liste des eaux que les apothicaires doivent avoir en leur boutique, il les classe d’après leurs vertus : encéphaliques, ophthalmiques, thoraciques, cardiaques, stomachiques, hépatiques, spléniques, néphrétiques, hystériques, arthritiques, etc. A propos du corail et des perles, voici ce que recommande La Framboisière : « Vous pilerez grossièrement le corail rouge, et vous le ferez dissoudre au bain marie, avec du suc de limons, ou de berbéris bien dépuré. Mais vous mettrez au feu les perles toutes entières,et les éteindrez plusieurs fois dans eau de vie, puis les dissoudrez au suc de limons, ou de berberis clarifié, ou bien au vinaigre alcalisé ou miellé, lequel vous séparerez après leur dissolution…. » La Framboisière poursuite par la préparation des huiles « tirées des simples », comme l’huile d’olive obtenu par expression, ou l’huile de cannelle, par distillation.
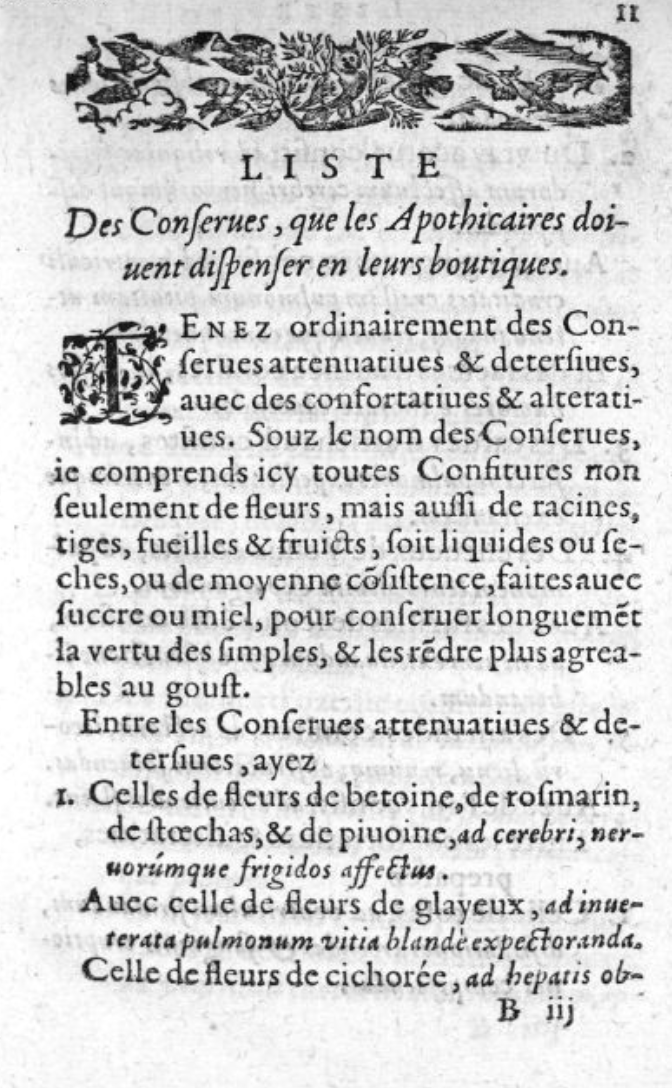
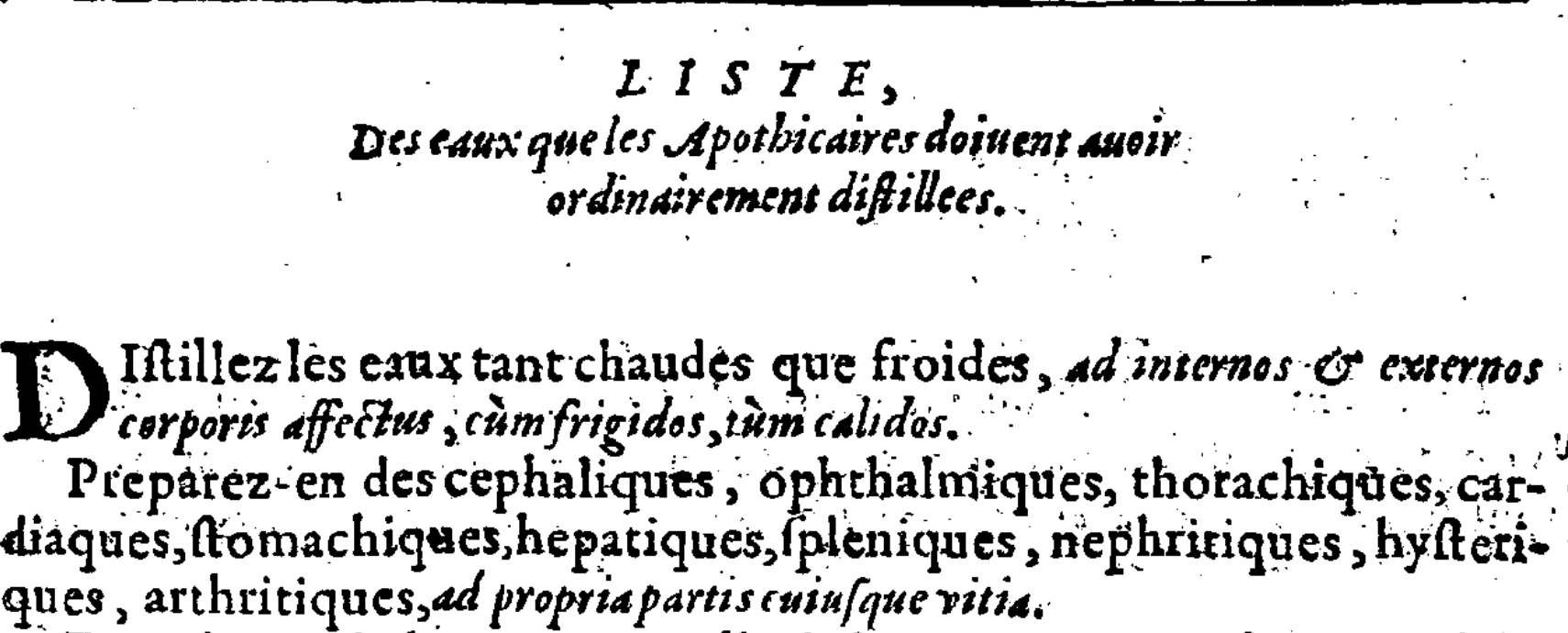
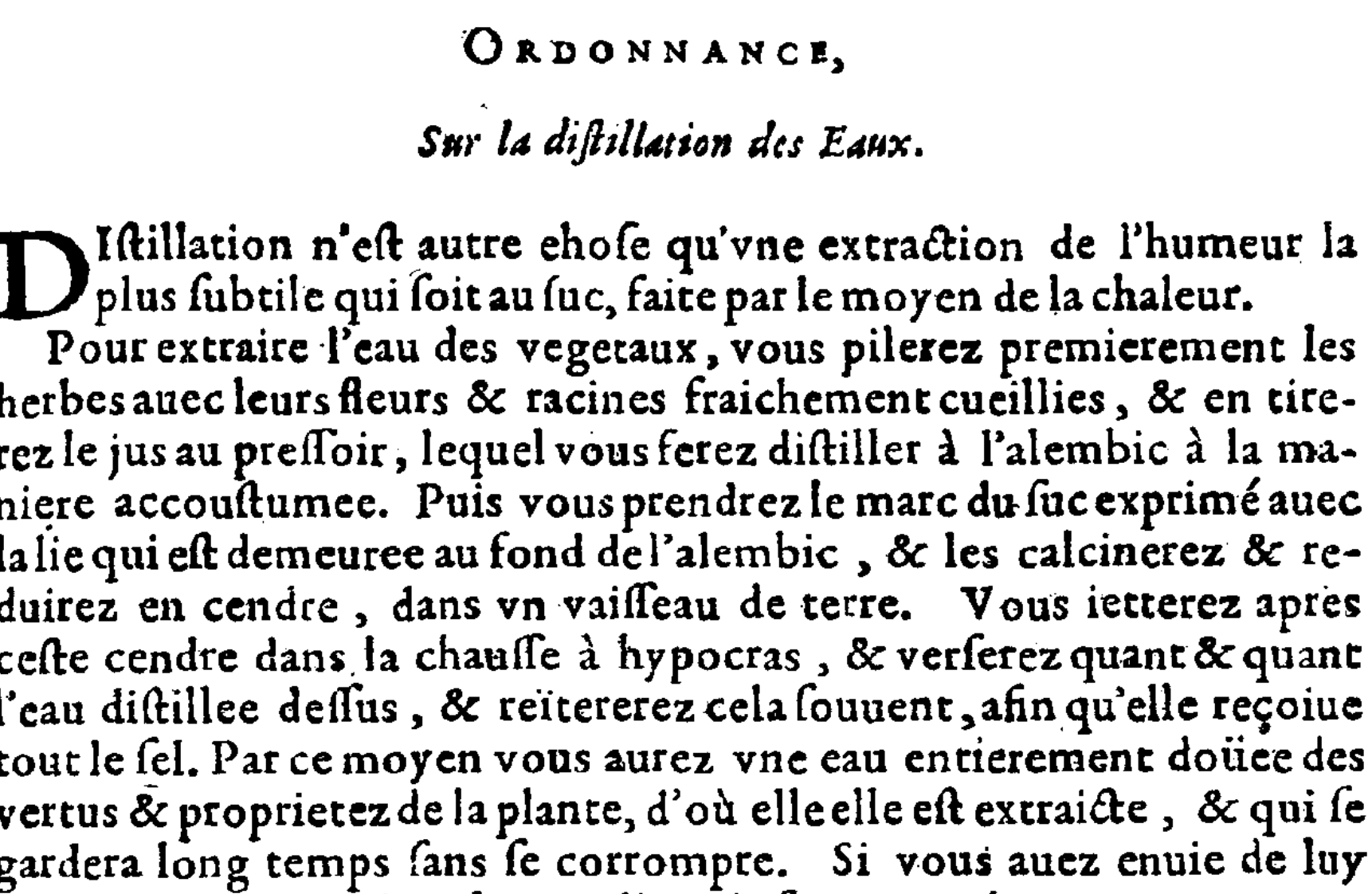
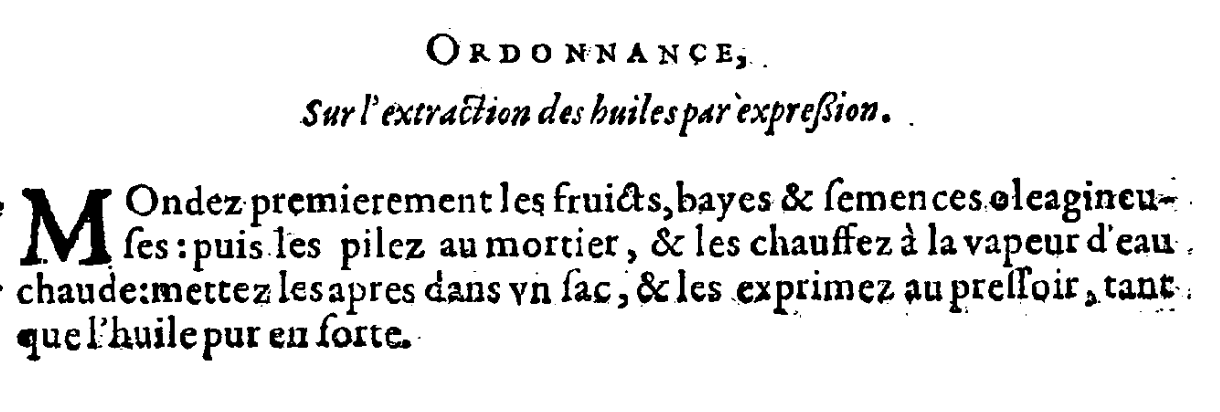
Plus loin, on trouve la liste des compositions que les apothicaires doivent dispenser ordinairement : conserves, sirops, électuaires, pilules, trochisques (qui sont des compositions internes), baumes, onguents et emplâtres (qui sont les externes). Chaque préparation est décrite très méthodiquement. Par exemple, La Framboisière explique la façon de faire les conserves purgatives à base de fleurs de pêcher, de pruniers sauvages et de centaurée : « Choisissez premièrement un pot de verre commode : faites y un lit de sucre en poudre, d’un doigt de haut, et par dessus un lit de fleurs de pêcher, de même épaisseur ; puis un autre lit de sucre : après un lit de felurs : conséquemment un de sucre, et encore un autre de fleurs au dessus, et enfin un de sucre pour couvrir les fleurs. A partir de là, fermer bien le vaisseau avec du parchemin, et le tenez un mois au soleil. Préparez de la même façon la conserve de fleurs de prunier sauvage, et celle des fleurs de la petite centaurée. »
L’auteur ajoute une « annotation » : Vous pouvez faire encore ces conserves d’une autre façon en laissant cuire le sucre en consistance d’électuaire solide, et en y mêlant après les fleurs pilées »
La Framboisière s’intéresse également aux sirops et fait la liste des sirops préparés par les apothicaires, comme ici les sirops laxatifs : sirop de roses pâles, sirop violat, etc. Là encore, l’auteur rentre dans le détail des opérations pharmaceutiques.
Pour le sirop de fleurs de pêcher, il donne la recette suivante : Mettez à tremper deux livres de fleurs de pêcher, fraîchement cueillies, dans six litres d’eau chaude, dans un pot de terre verni, douze heures durant. Puis les faire bouillir un bouillon sur le feu. Après les avoir exprimées, jetez les au loin et en infusez de nouvelles à leur place. Quand vous les aurez ainsi rechangées jusque huit ou neuf fois, clarifiez la colature, et laissez la cuire doucement avec le sucre fin en consistance de sirop.
Annotations : il faut au mois de mars, aussitôt que les pêchers viennent à fleurir, faire sur les cendres chaudes infuser les fleurs, non concassées, ainsi toutes entières, afin qu’elles soient plus purgatives. »
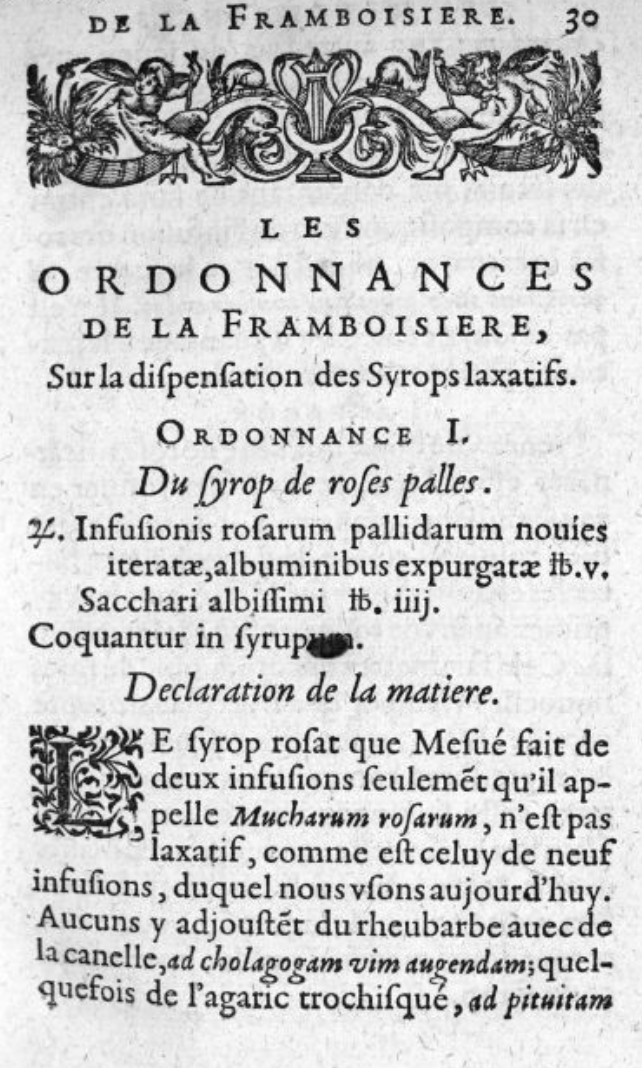
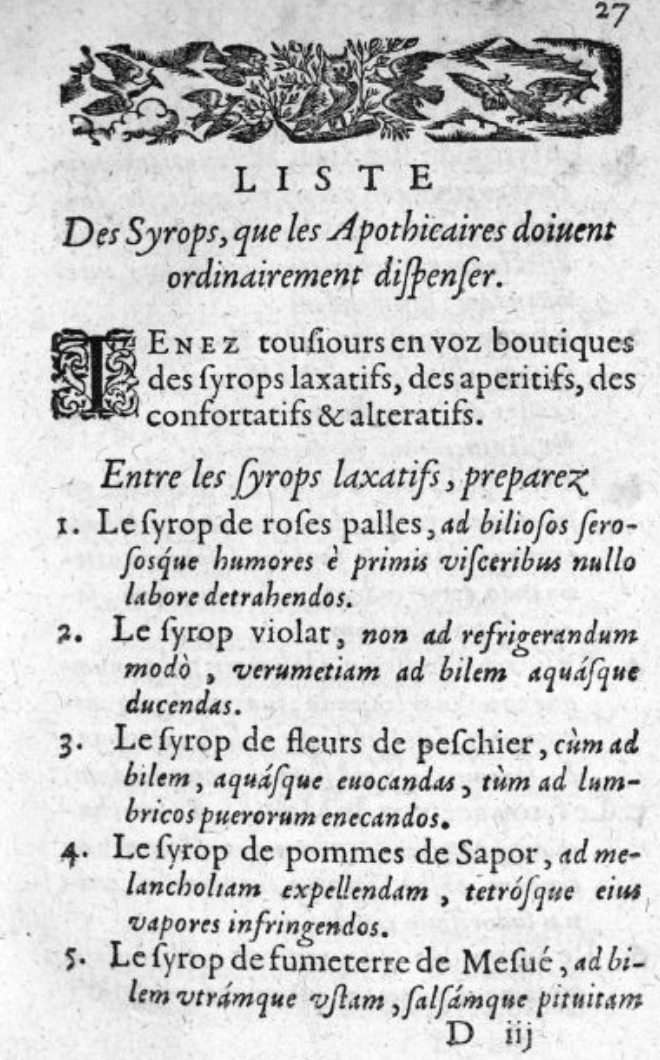
Après avoir examiné la composition des miels, Robs et Lochs, une partie importante du texte concerne les électuaires, « jadis nommés Antidotes par les Grecs. Ce sont des poudres incorporées avec miel ou sucre. De là vient qu’il y en a deux sortes : des mous en consistance d’opiat, des solides en forme de tablette. » La Framboisière poursuit : « pour préparer un électuaire mou, faites cuire doucement le miel sur le feu avec un peu d’eau, et l’écumez. Quand il sera bien purifié, retirez le du feu, et étant tiède, y jetez petit à petit les poudres, en les remuant toujours avec un pilon de bois, pour bien le mêler. Quand la confection sera entièrement refroidie, mettez la dans une boite, n’étant pas trop liquide, ni solide, afin que l’action mutuelle des ingrédients, la fermentation, se fasse mieux. » L’auteur fait ensuite une liste des « électuaires en opiat que les apothicaires doivent dispenser. « On retrouve dans cette liste le Catholicum de Nicolas, la Confection de Hamech de Mésué, la Bénédicte de Nicolas, etc. mais aussi le Mithridate de Damocrates et la Thériaque d’Andromaque, ou encore la Confection d’Alkermès.
A chaque fois, La Framboisine donne les ingrédients et leurs caractéristiques, la façon de préparer l’électuaire et les commentaires associés.
L’électuaire le plus complexe est évidemment la Thériaque : « Andromaque fait entrer dans la composition de la Thériaque des pastilles de vipère, des trochisques Hedychroï, des racines de gentiane, de valériane, de pentaphylum, etc. Après avoir expliqué comment préparer la Thériaque, La Framboisière fait quelques commentaires : La Thériaque a été composée par Andromaque de Candie, premier médecin de ce cruel Néron, empereur des Romains, en otant quelques ingrédients du Mithridate pour y mettre d’autres, qui lui semblait plus convenable à la morsure des bêtes venimeuses, comme la chair de vipères… Elle fut d’abord appelée Galène, qui signifie tranquille, parce qu’elle met en repos ceux qui sont travaillés de quelque maladie vénéneuse… Bien qu’il y ait un grand nombre de serpents, comme le basilic, le scorpion, l’aspic, le phalange, etc. Andromaque a choisi seulement la vipère parce que tous les autres ont leur venin répandu dans tout leur corps, comme l’enseigne Galien, et que la vipère l’a seulement dans sa tête et sa queue, et dans ses entrailles qu’on rejette. Et pour corriger le peu qui pourrait rester, on la fait cuire en eau, avec un peu de sel et beaucoup d’aneth, qui résiste au venins ».
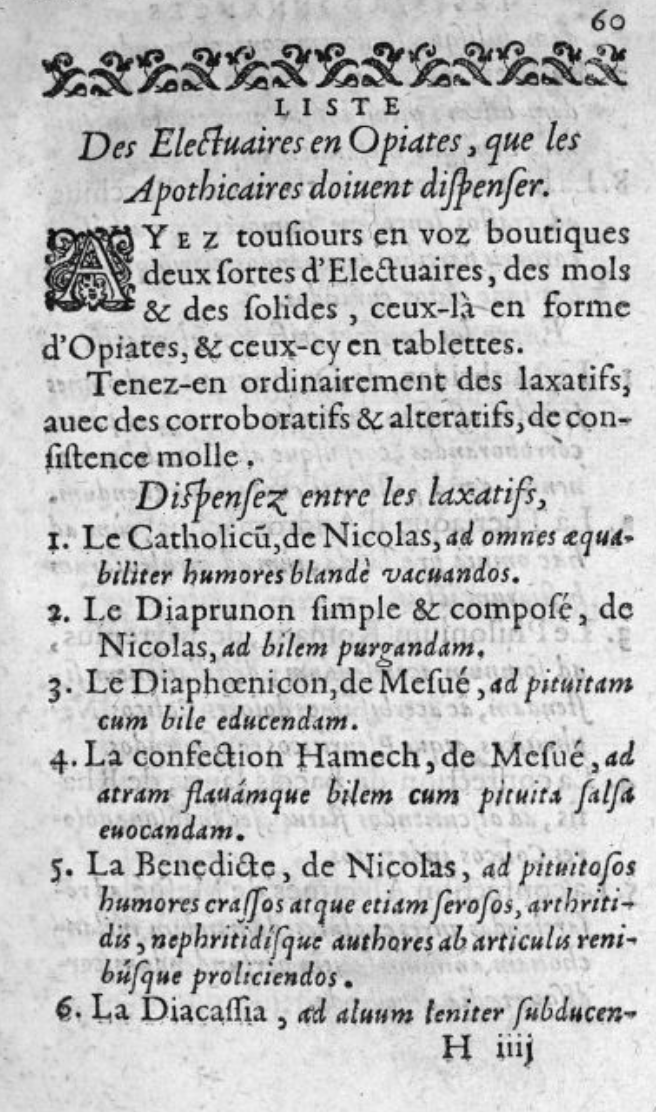
La Framboisière fait ensuite des commentaires sur chacun des ingrédients. Par exemple, le Bitume est comme une certaine graisse de la terre qui s’enflamme fort aisément. Il y en a deux sortes, l’une fort liquide, le pétroleum ; l’autre épaisse comme de la poix, qui nage sur l’eau, avant de se cailler et affermir, est celui de Judée qu’on appelle particulièrement asphaltos en Grec. le meilleur Bitume est celui qui reluit comme pourpre, qui est pesant de de forte odeur. Car celui qui est noir et sale est inutile. On le falsifie avec de la poix… »
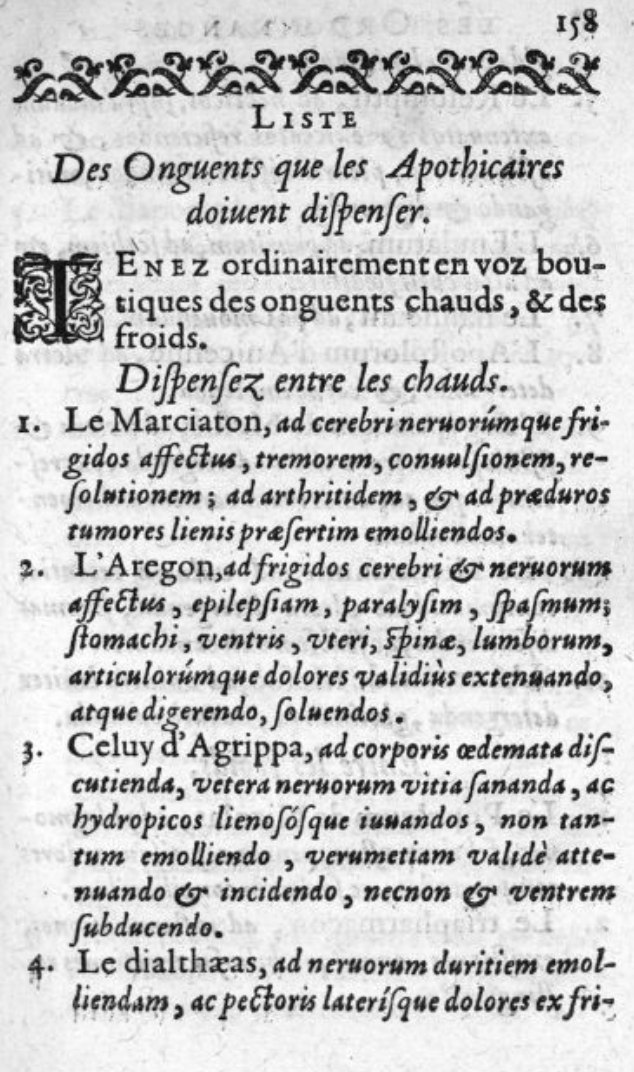
La Framboisière poursuit son volumineux ouvrage par la description des pilules, trochisques, huiles… et arrivent aux onguents et aux emplâtres. Comme pour les autres formes, il liste d’abord les onguents que les apothicaires doivent dispenser comme l’onguent d’Agrippa, le Marciaton, l’Aregon, etc. On peut examiner l’exemple de l’onguent égyptien de Mesué. « L’onguent appelé Egyptae, pour sa couleur basanée comme celle des Egyptiens, reçoit le miel, le verdet et le vinaigre… ».
Après avoir décrit la manière de préparer cet onguent, la Framboisière fait le commentaire suivant : « Mesué appelle cet onguent Aegyptiacum magnum, non pour faire la différence avec un autre plus petit, car il n’y en a pas, mais pour sa grande vertu. Aucuns y mêlent de l’encens. Avicenne et Guydon y ajoutent de l’alun. Et de Vigo de l’arsenic et du sublimé… Il vaut mieux que cet onguent ait une consistance molle, que trop dure, pour pouvoir plus aisément couvrir les tentes ».
Quant à « l’onguent de Nicotiane », il décrit sa composition et sa préparation et ajoute : « l’herbe dont cet onguent porte le nom, inconnue des anciens Grecs et Arabes, a été apportée de notre temps de la Floride (où on l’appelle Petum) au Portugal, et de là envoyée en France, par M. Jean Nicot, Conseiller du Roy, quand il était Ambassadeur pour sa Majesté en ce pays-là. C’est pourquoi nous la nommons aujourd’hui Nicotiane, afin de lui rendre l’honneur qu’il a mérité d’avoir enrichi ce Royaume d’une plante si singulière. Ses feuilles rendent un jus gluant et résineux, tirant sur le jaune, d’un goût acre et mordicant, qui démontre que l’herbe de la nature est chaude du moins au 2ème degré, et sèche au 1er. Les modernes ayant reconnu ses vertus en ont composé cet onguent, qui est excellent aux plaies récentes, aux écrouelles et à la galle, d’autant qu’il est triptyque et sarcoptique. »
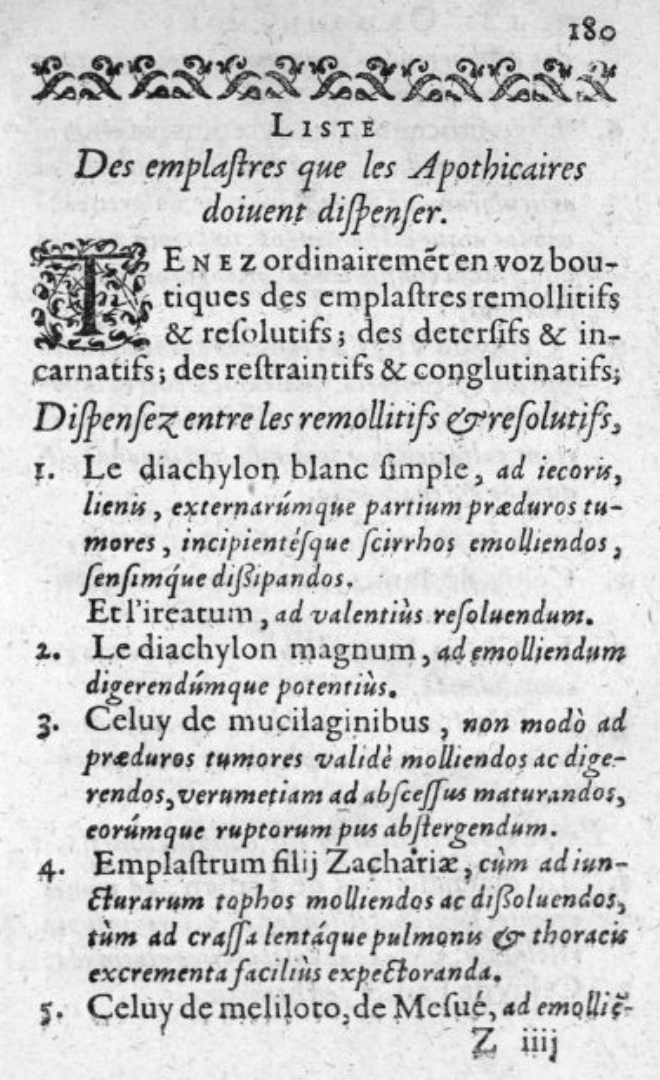
Enfin, s’agissant des emplâtres, La Framboisière en décrit de nombreux dont l’emplâtre Gratia Dei de Propositus. « L’auteur y fait entrer de la térébenthine, avec de la bétoine, de la résine, du mastic, de la pimprenelle, de la verveine et de la cire… Cet emplâtre est nommé Gratia Dei, à cause que ceux qui s’en servent à propos, en reçoivent un merveilleux contentement, comme ceux qui se sentent assistés de la grâce de Dieu. Au lieu du vin rouge, les autres prennent du vin blanc : mais par le témoignage d’Hippocrate et de Galien, je trouve le gros vin rouge plus propre pour conglutiner et consolider les plaies et viscères.
On voit ici un faible aperçu du volume de La Framboisière consacré principalement à la préparation des médicaments et qui comprend 868 pages !

